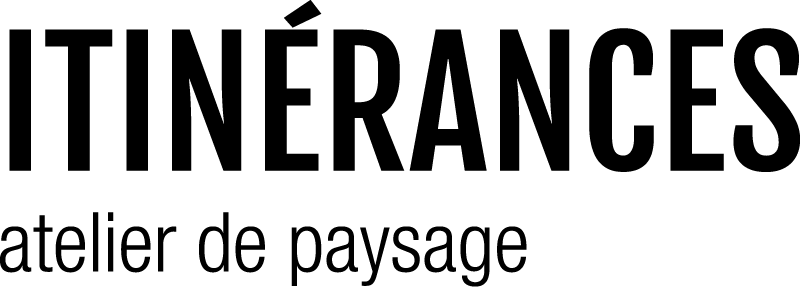PÈRE ET FILS
texte
J’ai rencontré B. dans les Cévennes, lors d’un de ces chantiers collectifs, à l’œuvre dans l’édifice des marges d’un système, qui assure une certaine intensité d’expériences. On y croise de ces personnages atypiques et poétiques, de retour de voyages, à l’autre bout du monde ou de leur imagination, en transit sur les chemins escarpés de leurs vies, dont elles et eux seules ont le contrôle. Artisans du système D, baba-punks et charpentier hacker, paysans pirates et poètes d’une autre galaxie, assurent ici clandestinement la contre bande du savoir-faire, la maîtrise et l’art de la débrouille.
On se quitte en échangeant nos adresses. Il me propose de faire escale par chez lui, lors de l’un de mes voyages.
Je n’ai pas refusé. Je n’ai pas regretté.
C’est ainsi que je découvre la Bourgogne, par un jour de pluie, qui ne rend que plus tragi-épique mon voyage en stop, jusqu’à L. . Le ciel se découvre à mon arrivée. Une brume épaisse se lève et coiffe les toits du petit village. L’image, d’un autre temps, est à la fois sévère et chaleureuse. Lovées au creux d’un vallon cultivé, les bâtisses, modestes mais solides, sont construites d’une pierre claire, du calcaire sans doute. De petites parcelles de jardins et de cultures nourricières s’immiscent dans le parcellaire dense et groupé du village. Au delà, des prairies semblent avoir été découpées à l’emporte-pièce dans les boisements de feuillus qui surmontent encore aujourd’hui le haut des collines. Contrairement à d’autres coins de la Bourgogne, L. et les villages alentours, sont implantées sur des terres relativement impropres aux cultures, parce que trop rocailleuses, et donc plus propices à l’élevage. Il s’est ainsi forgé, au cours du temps, une identité paysanne, humble et rustique, qui explique sans doute l’héritage politique très ancré de L. ainsi que le succès étonnant du front de gauche lors des dernières élections.
B. est aide familial dans l’exploitation de ses parents, éleveurs de chèvres. Ce statut autorise, ni plus ni moins, un salaire dissimulé par de l’argent de poche, profitant d’une ancienne tradition, une sorte de vide juridique. Tant mieux.
Il vit dans une caravane, installée un peu à l’écart du village, au bout d’un chemin, dans une combe de L., dont les versants boisés assombrissent le tableau. L’habitation solitaire est surmontée d’un toit de bois dont un pan se prolonge, pour mettre à l’abris l’entrée de la modeste demeure. Seule la fumée qui s’échappe de la cheminée anime la toile immobile.
La caravane comprend deux petites pièces, relativement exiguës. Un salon cuisine et une chambre. Pour l’instant la vie quotidienne s’organise autour de ces deux espaces. A côté, de petites structures, en cours de construction, laissent présager un avenir plus confortable. Des toilettes sèches, une douche, un sauna même.
Taillé sur le modèle bourguignon, comme il le dit lui-même, B. n’est pas spécialement grand mais développe une large cage thoracique, qui lui donne une allure terriblement solide. Son sourire laisse apparaître une fausse dent, un peu cassée, un peu noircie. Il semble directement sorti des entrailles de ses terres.
Quand on passe du temps ensemble dans la caravane, installés sur les banquettes en u et accoudés à la table de fortune, j’oriente souvent nos conversations vers leurs activités sur la ferme. J’adore l’entendre parler de ses chèvres, du fromage, des rythmes de la ferme, de leur choix, de leur modèle d’exploitation familiale. Je veux tout comprendre et tout savoir. Ce savoir me passionne.
Le père de B. élève des chèvres, donc, mais cultive avant tout le bon sens paysan.
Ici, tout est en équilibre. Tout est justifié. Tout a un sens. La production de fromage de chèvre est l’activité principale de l’exploitation mais entraine avec elle tout un système de production. Il y a, par exemple, quelques vaches sur l’exploitation. Onze plus précisément. Leur présence sert directement à équilibrer le fonctionnement de la chèvrerie. Les vaches mangent les rejets que laissent les chèvres dans les prairies. Elles produisent également beaucoup plus de fumier qu’elles, enrichissant ainsi les pâtures. Par ailleurs, elles ne sont pas sensibles aux mêmes parasites que les caprins et intègrent parfaitement la rotation des prairies. Laisser pâturer trop longtemps les chèvres aux mêmes endroits les amènerait à manger leur propre déjection, avec leurs propres parasites, ce qui, à terme, les rendrait malades ; en revanche, laisser trop longtemps les pâtures en jachère entraineraient un surcoût d’entretien pour l’éleveur et surtout sortiraient temporairement certaines parcelles du système productif. La présence des vaches permet, entre autres, de résoudre ce dilemme. Le père de B. fait également son foin et cultive certaines parcelles en céréales, lui permettant de nourrir ses bêtes en hiver et de leur apporter certains compléments alimentaires pour une meilleure qualité de lait. C’est ce qu’on appelle la polyculture élevage.
Le lait de chèvre est transformé sur place dans un petit atelier de transformation, dans un des bâtiments du corps de ferme. C’est essentiellement V., la mère de B., la femme de M., qui s’occupe de cette partie du travail. Un petit lieu de vente est aussi ouvert à cet endroit, ils n’y vendent que leur fromage, source unique de revenu de la ferme. Pour compléter les ventes directes, ils livrent quelques épiceries des villages alentours.
Le fromage qu’ils préparent tous les matins est dit à caillé lactique ; c’est à dire que le lait coagule à chaleur ambiante, en 24h, contrairement aux fromages à pates cuites. C’est la même préparation de lait cru, donc non pasteurisé, mélangé à des ferments, qui donne le fameux « caillé », servant de même base à tous les fromages. Ce sont les différents affinages et leurs formes qui feront leur spécificité. En fonction des saisons, un litre de lait donne différentes quantités de fromage. Ce ratio s’appelle un coefficient. C’est paradoxalement en pleine saison, alors que la production de lait est la plus importante, que ce coefficient est au plus bas.
Quand d’autres préfèrent modifier artificiellement les chaleurs de leurs animaux, à base d’hormones de synthèse, pour avoir du lait et donc du fromage toute l’année, M., le père de B., a fait le choix de ne pas contrarier le cycle naturel de ses chèvres. Les apprentis sorciers, quant à eux, divisent le troupeau en différents groupes, et provoquent les chaleurs de leurs animaux à différentes périodes, assurant ainsi une rotation dans la production du lait.
À L., l’année se rythment ainsi : les boucs rejoignent le troupeau en octobre et « font leur travail de boucs », comme dit B. . A partir de cette période, les quantités de lait diminuent, ne nécessitant alors plus qu’une traite par jour, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lait du tout. La mise-bas a lieu fin février ou début mars. À partir de ce moment la production de lait augmente de façon croissante, et ce, jusqu’à l’été. Deux traites par jour sont alors nécessaires : une le matin et une le soir. Toujours à la même heure. Les chèvres sont rassurées par les heures fixes.
Avant chaque manipulation, chaque traite ou chaque visite, B. regarde son troupeau, de la même manière que son père, avec ce même œil. Le signaler n’est ni un détail ni anecdotique. Ce regard est si long et si intense qu’il ne peut laisser indifférent l’étranger ou l’étrangère qui les accompagne. Ce regard est si long et si intense qu’il ne peut être passer sous silence. Il dit à lui seul, à qui veut bien le comprendre, tout l’amour, le soin et le respect qu’ils portent à leur troupeau. Ils le regardent avec cette attention profonde. Le temps semble s’arrêter autour d’eux ; il me plaît à croire qu’ils entrent en communication. C’est à ces moments là, attentifs à chaque détail, à chacune de leurs bêtes, qu’ils écoutent leur humeur, leur envie, qu’ils repèrent celle qui boite, celle qui est blessée ou celle qui est malade. Un regard presque amoureux.
Une telle passion, un tel amour, un tel bon sens ne peuvent se heurter qu’avec fracas contre le fonctionnement dominant de nos campagnes contemporaines ; ne peut qu’entrer en lutte profonde et viscérale contre un système agricole conventionnel qui réduit à néant la relation de l’homme avec son environnement. La comparaison des deux modèles est brutale et violente. Que s’est-il donc passé, ses dernières années, pour que l’on s’égard autant, pour qu’on se perde en chemin ?
Syndiqué et investi à la confédération paysanne, M. prend aujourd’hui de plus en plus de temps sur son exploitation pour que soit mieux reconnue l’agriculture paysanne. M. milite pour une meilleure compréhension et prise en compte de son modèle de culture ; il se bat pour réduire le décalage, l’abysse, qui sépare le fonctionnement juridico-administratif des réalités de leurs exploitations. Le fonctionnement de la PAC, trop moderne et trop archaïque à la fois ; le calcul des primes à l’hectare et non à l’activité, à la quantité et non à la qualité ; l’établissement de seuils et non de plafonds pour calibrer les subventions allouées à un troupeau, le financement de la conversion au bio et non de l’accompagnement, autant d’aberrations qui régissent et façonnent le système agricole actuel ; autant de combats à mener, avec patiente et minutie, par la révision progressive des textes et des lois.
Bien que le rapport de force soit désolant ; bien que les voix de la confédération paysannes n’aient que peu de poids dans les assemblées officielles, où les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de syndiqués ; bien qu’il y ait bien plus d’adhérents aux amis de la conf’ que de paysans syndiqués à la confédération paysanne ; bien que, M. se retrouve souvent bien seul avec ses quelques ami.e.s pour porter à bout de bras une dynamique alternative et pour organiser la propagande de leur réseau, M. ne semble pas se décourager pour autant.
B., quant à lui, ne comprend que trop bien son père mais avec du recul, depuis sa caravane, se demande si c’est bien de ça dont il a envie.
Il a vu son père se lever à l’aube, tous les matins de l’année, sans exception aucune, pour s’occuper de ses bêtes ; l’a vu travailler sans relâche ; pleurer la régression du nombre d’agriculteurs, et par la même, pleurer la disparition progressive des liens d’entraide qu’il y avait entre eux. Il ne connaît que trop d’exploitants en grandes difficultés, isolés, et n’a que trop entendu d’histoires de paysans qui ont fini la corde au cou. Inutile de rappeler que le métier d’agriculteur est celui qui enregistre le plus haut taux de suicide en France.
« Quand ces cons d’agriculteurs descendent dans la rue, en Bretagne ou ailleurs, c’est pour cette vie de merde et ce système qui les enferme, qu’ils se battent », pris au piège, empêtrés, aveuglés, sans se rendre compte qu’ils sont déjà pendus. Haut et court.
Il se dit qu’il vaudrait peut-être mieux que tout se casse la gueule, bien bas, s’effondre lamentablement, une bonne fois pour toute pour qu’on puisse repartir. Mieux. Autrement.
B. ne reprendra donc pas l’exploitation de ses parents. Aujourd’hui, depuis sa caravane, il s’imagine plutôt aux côtés de celles et ceux qui choisissent ensemble leur propre itinéraire, en dehors des sentiers battus ; qui s’organisent à plusieurs, en collectifs, en réseaux, en autonomie, dans les coulisses étroites d’un système dominant ; qui n’attendent pas qu’on leur donne l’autorisation pour penser différemment ; qui ne resteront à genou, en spectateurs de cette farce, de cette comédie de mauvais goût ; qui ne se gênent pas pour détourner le RSA afin de financer leur projet de vie, tellement plus riches de sens que tant de projets subventionnés par la PAC. En attendant, B. donne de son temps, de son énergie, ici et là, à l’occasion de chantiers collectifs auto-gérés, auto-conçus, auto-produits, dans ces lieux qui réinventent au quotidien les liens de solidarité et d’entraide qui existaient naturellement dans nos campagnes, faisant le sel de la vie paysanne.
Je crois qu’il croit profondément à la force et au potentiel révolutionnaire de ces alternatives, en l’impact direct qu’elles ont sur leur environnement et sur la société qui les entoure. On ne repensera pas les modèles agricoles, sans revoir le projet social.
C’est la deuxième fois que je rends visite à B. . Les couleurs de l’autonome ont transformé le paysage que j’avais en mémoire. Les feuillages se sont enflammés de mille couleurs rougeoyantes. Alors, les lumières du soir offrent aux badauds un spectacle de feux et lumières immobile et enflamment par leurs derniers rayons les boisements ardents. Seuls les quelques plantations de douglas restent insensibles à cet évènement climato-artistique et absorbent toute la lumière dans leur sombres épines. A croire, qu’ils n’ont pas leur place ici.