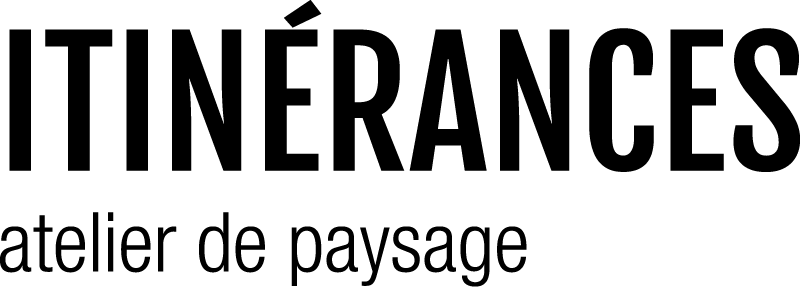L’homme révolté, Camus
extrait choisi
La sculpture ne rejette pas la ressemblance dont, au contraire, elle a besoin. Mais elle ne la recherche pas d’abord. Ce qu’elle cherche, dans ses grandes époques, c’est le geste, la mine ou le regard vide qui résumeront tous les gestes et tous les regards du monde. Son propos n’est pas d’imiter, mais de styliser, et d’emprisonner dans une expression significative la fureur paysagère des corps ou le tournoiement infini des attitudes. Alors, seulement, elle érige, au fronton des cités tumultueuses, le modèle, le type, l’immobile perfection qui apaisera, pour un moment, l’incessante fièvre des hommes. L’amant frustré de l’amour pourra tourner enfin autour des corés grecques pour se saisir de ce qui, dans le corps et le visage de la femme, survit à cette dégradation.
« Marx se demande, il est vrai, comment la beauté grecque peut encore être belle pour nous. Il répond que cette beauté exprime l’enfance naïve d’un mode et que nous avons, au milieu, de nos luttes d’adultes, la nostalgie de cette enfance. Mais comment les chefs d’œuvre de la Renaissance italienne, comment Rembrandt, comment l’art chinois, peuvent-ils être encore beaux pour nous ? Qu’importe ! Le procès de l’art est engagé définitivement et se poursuit aujourd’hui avec la complicité embrassée d’artistes et d’intellectuels voués à la calomnie de leur art et de leur intelligence. On remarquera en effet que, dans cette lutte entre Shakespeare ou le cordonnier, ce n’est pas le cordonnier qui maudit Shakespeare ou la beauté, mais au contraire celui qui continue de lire Shakespeare et ne choisit pas de faire les bottes, qu’il ne pourrait jamais faire au demeurant. Les artistes de notre temps ressemblent aux gentilshommes repentants de la Russie, au XIXème siècle ; leur mauvaise conscience est leur excuse.
Mais la dernière chose qu’un artiste puisse éprouver devant son art est le repentir. C’est dépasser la simple et nécessaire humilité que de prétendre renvoyer la beauté aussi à la fin des temps, et, en attendant, priver tout le monde, et le cordonnier, de ce pain supplémentaire dont on a soi-même profité.
Cette folie ascétique a pourtant ses raisons, qui, elles, du moins nous intéressent. Elles traduisent, sur le plan esthétique, la lutte, déjà décrite, de la révolution et de la révolte. Dans toute révolte se découvrent l’exigence métaphysique de l’unité, l’impossibilité de s’en saisir et la fabrication d’un univers de remplacement. La révolte de ce point de vue, est fabricatrice d’univers. L’exigence de la révolte, à vrai dire, est en partie une exigence esthétique. Toutes les pensées révoltées, nous l’avons vu, s’illustrent dans une rhétorique ou un univers clos. La rhétorique des remparts chez Lucrèce, les couvents et les châteaux verrouillés de Sade, l’île ou le rocher romantique, les cimes solitaires de Nietzsche, l’océan élémentaire de Lautréamont, les parapets de Rimbaud, les châteaux terrifiants qui renaissent, battus par un orage de fleurs chez les surréalistes, la prison, la nation retranchée, le camp de concentration, l’empire des esclaves, illustrent à leur manière le même besoin de cohérence et d’unités. Sur ces mondes fermés, l’homme peut régner et connaître enfin.
Ce mouvement est aussi celui de tous les arts. L’artiste refait le monde à son compte. Les symphonies de la nature ne connaissent pas de point d’orgue. Le monde n’est jamais silencieux ; son mutisme même répète éternellement les mêmes notes, selon les vibrations qui nous échappent. Quand à celles que nous percevons, elles nous délivrent des sons, rarement un accord, jamais une mélodie. Pourtant la musique existe où les symphonies s’achèvent, où la mélodie donne sa forme à des sons qui, par eux-mêmes, n’en ont pas, où une disposition privilégiée des notes, enfin, tire du désordre naturel une unité satisfaisante pour l’esprit et le cœur. »
(…)
» Le principe de la peinture est aussi dans le choix. « Le génie même, écrit Delacroix, réfléchissant sur son art, n’est que le don de généraliser et de choisir » Le peintre isole son sujet, première façon de l’unifier. Les paysages fuient, disparaissent de la mémoire ou se détruisent l’un l’autre. C’est pourquoi le paysagiste ou le peintre de natures mortes isole dans l’espace et dans le temps ce qui normalement, tourne avec la lumière, se perd dans une perspective infinie ou disparaît sous le choc d’autres valeurs. Le premier acte du paysagiste est de cadrer sa toile. Il élimine autant qu’il élit. De même, la peinture de sujet isole dans le temps comme dans l’espace de l’action qui, normalement, se perd dans une autre action. Le peintre procède alors à une fixation. Les grands créateurs sont ceux qui, comme Piero della Francesca, donnent l’impression que la fixation vient de se faire, l’appareil de projection de s’arrêter net. Tous leurs personnages donnent alors l’impression que, par le miracle de l’art, ils continuent d’être vivants, en cessant cependant d’êtres périssables. Longtemps après sa mort, le philosophe de Rembrandt médite toujours entre l’ombre et la lumière sur la même interrogation. «